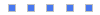

| Ordell Robbie | 1.5 | Dommage que ce soit signé Yasuda... |
| drélium | 3.75  |
Rise of the Colossus |
| Astec | 3.5  |
Si Rodin avait été japonais... |

Le cas Daimajin est assez atypique dans l'histoire du Kaiju Eiga pour qu'on s'y intérèsse. Car au visionnage on comprend pourquoi cette tentative de la DAIEI de concurrencer Godzilla n'a pas duré longtemps: si la série a bien marché au Japon, le coté très marqué culturellement de la légende dont il était tiré ainsi que le peu de scènes de monstres expliquent que le film n'ait pu s'exporter aussi bien que le dinosaure de Honda. La DAIEI avait alors voulu transférer son savoir-faire dans le domaine du drame historique et du film de sabre au kaiju eiga. En résulte un film ne faisant aucun cas des codes du genre. On n'y voit en effet le géant de pierre que durant le dernier quart d'heure. Durant tout le film, il n'est là que comme enjeu narratif, d'abord parce que sa peur est utilisée par un clan pour asservir un village et ensuite parce qu'il sera l'instrument de la progressive vengeance de rebelles ayant quitté le village. Certes, le scénario n'a pas la densité romanesque d'un Lady Snowblood Blizzard from the Netherworld mais le film se laisse néanmoins suivre. Problème: la mise en scène de Yasuda Kimiyoshi est d'une platitude extrême, du travail de tâcheron tirant le film vers le bas. Reste une direction d'acteurs correcte dans un registre pathétique retenu. Un kaiju eiga médiocre de plus.

 Il est tellement difficile de rendre un Kaiju Eiga crédible et tellement fréquent d'obtenir un sous produit que Daimajin sort d'emblée du lot tant son contexte féodal tout à fait inédit a son mot à dire. D'autant qu'il date de 1966 ! C'est à peine croyable tant les techniciens des effets spéciaux de Gamera maitrisent ici le final avec brio, hormis quelques petits problèmes d'échelle par ci par là. En s'appuyant pendant la majeure partie du film sur un jidai geki (film historique donc), on pouvait craindre l'absence du colosse, finalement pas du tout. Le mythe du Majin permet au reste du film d'être désespéré à volonté puisque le sauveur de la situation n'est autre que le colosse dont l'absence accroit sans problème la mystique. On en parle, on ose à peine prononcer son nom, mais lorsque l'oppresseur du peuple se décide enfin à déclencher sa colère et qu'il daigne finalement se mettre à bouger, il y a comme de l'électricité dans l'air qui prouve que l'attente n'aura pas été vaine. Sans être exceptionnelle, la grosse partie jidai geki reste tout à fait maitrisée, toujours entrainante et même parsemée de beaux instants comme la promesse de la sorcière, le gamin qui pénètre dans la forêt débordante d'esprits ou la prière de la princesse. L'ambiance à du goût et pas de doute, il a de la gueule ce Majin.
Il est tellement difficile de rendre un Kaiju Eiga crédible et tellement fréquent d'obtenir un sous produit que Daimajin sort d'emblée du lot tant son contexte féodal tout à fait inédit a son mot à dire. D'autant qu'il date de 1966 ! C'est à peine croyable tant les techniciens des effets spéciaux de Gamera maitrisent ici le final avec brio, hormis quelques petits problèmes d'échelle par ci par là. En s'appuyant pendant la majeure partie du film sur un jidai geki (film historique donc), on pouvait craindre l'absence du colosse, finalement pas du tout. Le mythe du Majin permet au reste du film d'être désespéré à volonté puisque le sauveur de la situation n'est autre que le colosse dont l'absence accroit sans problème la mystique. On en parle, on ose à peine prononcer son nom, mais lorsque l'oppresseur du peuple se décide enfin à déclencher sa colère et qu'il daigne finalement se mettre à bouger, il y a comme de l'électricité dans l'air qui prouve que l'attente n'aura pas été vaine. Sans être exceptionnelle, la grosse partie jidai geki reste tout à fait maitrisée, toujours entrainante et même parsemée de beaux instants comme la promesse de la sorcière, le gamin qui pénètre dans la forêt débordante d'esprits ou la prière de la princesse. L'ambiance à du goût et pas de doute, il a de la gueule ce Majin.

Premier des trois opus qui constituent la saga Daimajin, ce film met en place la recette à la base de la réalisation de ses deux suites. En un certains sens voir le premier c’est un peu déjà voir les suivants tant les structures narratives ainsi que les climax finaux peuvent être interchangeables. Et ce qui est valable sur le plan du scénario et de sa mise en scène vaut également pour l’aspect technique et artistique. Loin de constituer un défaut ce cachet serial très prononcé fait en partie le charme de ces kaiju eiga en garantissant un plaisir égal tout au long de leurs visionnages. Si des scènes, des plans, des personnages... sont plus ou moins bien réussis d’un épisode à l’autre, dans l’ensemble le résultat tend à être constant et dans tous les cas « égalisé » par le final systématique qui ponctue toutes les histoires : un quart d’heure d’action exclusivement consacrée à Majin.

Nous avons donc au début la mise en place d’une situation typique de tout jidaigeki (film historique) qui se respecte. Un juste seigneur assassiné par un lieutenant ambitieux et sans pitié. De jeunes héritiers qui réussissent à s’échapper grâce à l’aide d’une galerie de samouraïs dévoués, une populace et des paysans accablés... A ce stade le script de Yoshida s’apparente quasiment à un cliché tant les situations convenues s’enchaînent mécaniquement et sans surprises. Mais c’est sans compter avec la dimension kaiju inédite qui fait toute l’originalité de cette production, Daiei tentant ainsi de capitaliser sur le savoir faire, en matière de grands monstres, accumulé en travaillant sur son kaiju eiga à succès concurrent du Godzilla de la Toho en ces années 60 : Gamera. Le studio nippon a d’ailleurs signé sa note d’intention on ne peut plus clairement en engageant, comme réalisateur de ce premier volet, un habitué des "films de samourais": Yasuda Kimiyoshi s’est auparavant –et par la suite- notamment distingué en réalisant 6 films de la longue série Zatoichi, dont le fameux Zatoichi meets the One Armed Swordsman. Le savoir faire de Yasuda, pas si novice que ça dans le fantastique également comme l’atteste son Kaidan de 1960, s’il reste sur un terrain balisé dans le domaine du film d’époque, s’amalgame dès lors avec les effets spéciaux (maquettes, bonhomme dans son costume de Majin, truquages optiques...) de Kuroda Yoshiyukin qui assure ici une sorte de « veille technologique » puisqu’on le retrouve, contrairement au réalisateur, au même poste (sfx) sur les trois segments Daimajin.
Et donc très vite, en plus de l’intrigue cliché de légitimité féodale, se dessine une dimension purement fantastique avec l’évocation du « Dieu de la Montagne » dont il ne faudrait pas provoquer la colère..., ce que le méchant de service s’empresse, pour notre plaisir, de faire. Dès lors toute la mise en scène nous prépare au duel final qui verra la juste punition, dans le sang, du vil usurpateur et blasphémateur de surcroît. Comme dans un film de samouraïs sauf qu’ici ce n’est pas un Mifune ou un Nakadai qui fait office de justicier mais une statue vivante de plusieurs mètres de haut. Les autres aspects du scénario, de par leur caractère ultra codifié, s’apparentent en contraste à de la péripétie qui reste quand même agréable à regarder grâce à la qualité de l’ensemble –photo, couleurs, figurants, décors, musique...-, nous rappelant que l’ère des grands studio japonais avec leurs cortèges de personnels spécialisés et ultra qualifiés, n’était pas encore révolue. Le mélange des genres fonctionnant dans les deux sens, ce duel final pend la forme typique des affrontements de kaiju où à la fureur dévastatrice du Titan les humains opposent, en vain, leur puissance technologique. Dans les « Godzilla and co » ces moments sont en général synonymes de moult tanks, avions et armes « science fictionnesques » aussi efficaces que la Ligne Maginot. Dans Daimajin, étant donné le contexte historique, les tanks se sont transformés en sabre et poudre, les buildings en un domaine seigneurial, mais le résultat reste le même : c’est tout cassé à la fin.
Les années 60 marquent l’apogée des kaiju gentils dans les salles japonaises, alors que le genre finit son processus d’infantilisation, et Majin n’échappe pas à la règle (il punit les méchants). Mais sa plastique inédite et édifiante ainsi que son regard furieux et la rage froide qui semble l’habiter dans la séquence finale, épargnent facilement à la statue de la Daiei le sort d’un « fils de Godzilla »... Y’a pas à dire, il en jette le Majin...


