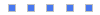
Lu dans Mad Movies n°136 : « Le climax, très réussi (combat façon Hong Kong avec des armes à la Soul Calibur) vient achever la trilogie en beauté. ». Cette phrase ne concerne pas la dernière production hollywoodienne mettant en vedette un acteur ou un chorégraphe hongkongais connu, mais le troisième volet de Prophecy, une saga fantastique « direct to video » qui met en scène Christopher Walken dans une histoire aux accents bibliques narrant une guerre parmi les anges descendus sur Terre. Nous sommes à priori bien loin de l’univers du cinéma HK (genre et casting) et pourtant le « climax », moment clé du film, doit presque tout à sa touche résolument « à la HK » comme il est coutume de le dire. On peut ainsi mesurer, à travers ce cas, l’influence décisive qu’exerce actuellement la « Hong Kong touch » dans le cinéma de genre occidental.
En vingt ans le statut du cinéma HK s’est successivement résumé, dans la presse en général, par des « oh, c’est un film de karaté ! », à « filmé à la John Woo » puis « combat à la Matrix » et enfin « par le directeur des combats Yuen Woo-Ping ». En d’autres termes, considérés jusque dans les années 80 comme des ovnis cinématographiques, les films de kung-fu et de chevalerie sont donc passés, en une décennie, du statut de bizarreries culturelles à celui de références pour cinéphiles branchés, avant de bénéficier de la reconnaissance implicite des frères Watchiowski, et enfin d’une reconnaissance ouverte dont témoigne, aujourd’hui, la sortie en salle de long-métrages directement issus de l’ex-colonie britannique. Charles Tesson, dans un ouvrage récent des Cahiers du Cinéma au titre évocateur (L’Asie à Hollywood), résume assez bien l’enjeu de la nouvelle époque ouverte par la « popularisation » occidentale du cinéma HK : « Le cinéma d’arts martiaux de Hong Kong a envahi le cinéma américain, y compris sous forme de clin d’œil, à l’image de la princesse de Shrek en reine de kung-fu. Les bagarres homériques des films de John Ford, d’Howard Hawks et de Raoul Walsh ont disparu au profit de nouvelles techniques de combat. (...) L’Asie à Hollywood, c’est d’abord cela. Plus que des noms d’acteurs, plus que des noms de personnages, son apport se résume à une transformation de la figure de base qui caractérise le cinéma hollywoodien au fil des ans : l’affrontement à deux». (p. 7)
Mais toute la question est de savoir dans quelle mesure cette transformation préserve ce qui faisait l’attrait le plus original du « vrai » cinéma d’arts martiaux... Il y a quatre ans le fan et le critique se demandaient, légitimement, si la greffe allait prendre. A l’heure où Iron Monkey et Taï-Chi Master célèbrent leurs sorties occidentales avec 10 ans de décalage, le doute n’est plus de mise, pour le meilleur comme pour le pire…
 Une
nouvelle période se dessine pour le cinéma de genre hongkongais, en particulier
pour les films d’arts martiaux et en costumes. Si la performance de Matrix
(combinée à la crise de l’industrie du septième art à Hong Kong à cette
période) ainsi que l’arrivée massive en terre américaine de la crème des
acteurs martiaux, chorégraphes et cascadeurs (1),
pouvaient laisser présager de sombres jours pour le futur (agonie de l’industrie
locale ?), le succès de Tigre et Dragon
a finalement suscité l’intérêt du public et des studios pour des œuvres
authentiquement hongkongaises. Bien que les sorties en salles concernent
avant tout des noms connus des occidentaux (Yuen
Woo Ping, Jet Lee, Michelle
Yeoh…), le fait est assez significatif pour avoir un sens plus qu’anecdotique
car il va au-delà de la simple appropriation, par la machine hollywoodienne
(entendez « le cinéma d’amusement occidental »), d’un savoir-faire. Fist
of Legend ou Iron Monkey sont des films qu’Hollywood sera, probablement,
à jamais incapable de produire et ce non pour des raisons techniques mais
culturelles. Aujourd’hui ce n’est plus simplement le style HK qui s’impose
mais bien son cinéma dans ce qu’il a de plus singulier ou « exotique » :
« C’est l’Asie qui propose, désormais, des films excitants et des réalisateurs
doués. Les films asiatiques sont frais et on sent que l’on est en présence
de quantité de nouveaux talents explosifs. Lorsque nous étions à Cannes
l’année dernière, pour Tigre et Dragon, c’était extraordinaire de voir la
quantité de bons films asiatiques présents, tous plus viscéraux les uns
que les autres ». (Michael Barker, co-président de Sony Pictures Classics)
Une
nouvelle période se dessine pour le cinéma de genre hongkongais, en particulier
pour les films d’arts martiaux et en costumes. Si la performance de Matrix
(combinée à la crise de l’industrie du septième art à Hong Kong à cette
période) ainsi que l’arrivée massive en terre américaine de la crème des
acteurs martiaux, chorégraphes et cascadeurs (1),
pouvaient laisser présager de sombres jours pour le futur (agonie de l’industrie
locale ?), le succès de Tigre et Dragon
a finalement suscité l’intérêt du public et des studios pour des œuvres
authentiquement hongkongaises. Bien que les sorties en salles concernent
avant tout des noms connus des occidentaux (Yuen
Woo Ping, Jet Lee, Michelle
Yeoh…), le fait est assez significatif pour avoir un sens plus qu’anecdotique
car il va au-delà de la simple appropriation, par la machine hollywoodienne
(entendez « le cinéma d’amusement occidental »), d’un savoir-faire. Fist
of Legend ou Iron Monkey sont des films qu’Hollywood sera, probablement,
à jamais incapable de produire et ce non pour des raisons techniques mais
culturelles. Aujourd’hui ce n’est plus simplement le style HK qui s’impose
mais bien son cinéma dans ce qu’il a de plus singulier ou « exotique » :
« C’est l’Asie qui propose, désormais, des films excitants et des réalisateurs
doués. Les films asiatiques sont frais et on sent que l’on est en présence
de quantité de nouveaux talents explosifs. Lorsque nous étions à Cannes
l’année dernière, pour Tigre et Dragon, c’était extraordinaire de voir la
quantité de bons films asiatiques présents, tous plus viscéraux les uns
que les autres ». (Michael Barker, co-président de Sony Pictures Classics)
Le kung-fu frappe fort !
Bien que Tigre et Dragon, avec plus de 150 millions de dollars de
recettes dans le monde, marque la véritable naissance internationale des
films de genre chinois, il n’en garde pas moins un caractère d’exception
de par sa nature fondamentalement apatride. En effet, s’il possède un staff
technique et un casting majoritairement issu de l'’ex-colonie britannique,
en plus de son sujet typique (wu xia pian), Tigre
et Dragon est aussi le fruit d’une production rendue possible par la
grâce de capitaux venus directement de Sony, via la Columbia. Et avec une
volonté évidente de formater sa mise en scène pour  la
rendre plus accessible au public occidental (2),
Ang Lee a finalement accouché d’une œuvre à mi-chemin
entre deux façons de faire cinéma : « Tigre et Dragon incarne probablement
l’hypothèse la moins passionnante entre cinéma de Hong Kong traditionnel
et divertissement de masse fabriqué avec des capitaux américains à destination
du marché mondial. Ici la contrefaçon prend soin de ne surtout pas s’afficher
comme telle. Tigre et Dragon est un objet lisse, toutes les scories propres
au wu xia pian chinois, son aspect bricolé et sauvage, ont été soigneusement
gommées. (...) Les personnages héroïques du film de sabre sont « psychologisés »
à coup de tunnels de dialogues et quelque chose de l’ordre de la figuration/
défiguration du corps humain, qui fut la marque du très grand cinéma d’art
martial chinois, s’abolit dans ce livre d’image climatisée. ». (Jean-Marc
Lalanne, essais L’Asie à Hollywood, p. 136) De fait, plutôt qu’un film
précurseur, il faut y voir un pont entre deux traditions cinématographiques
mais également un point d’appui (financier) pour des studios occidentaux
avides de capitaliser sur le même créneau (3),
tout comme un point d’appui (culturel ?) pour des spectateurs avides de
nouveaux horizons : « Tigre et Dragon fut le point de masse critique
où plus personne ne pouvait être en désaccord et devait admettre qu’il y
avait là quelque chose. Et avec un tel accueil du public viennent de nouvelles
opportunités pour essayer encore plus de nouvelles choses ». (Mark Gill,
président de Miramax)
la
rendre plus accessible au public occidental (2),
Ang Lee a finalement accouché d’une œuvre à mi-chemin
entre deux façons de faire cinéma : « Tigre et Dragon incarne probablement
l’hypothèse la moins passionnante entre cinéma de Hong Kong traditionnel
et divertissement de masse fabriqué avec des capitaux américains à destination
du marché mondial. Ici la contrefaçon prend soin de ne surtout pas s’afficher
comme telle. Tigre et Dragon est un objet lisse, toutes les scories propres
au wu xia pian chinois, son aspect bricolé et sauvage, ont été soigneusement
gommées. (...) Les personnages héroïques du film de sabre sont « psychologisés »
à coup de tunnels de dialogues et quelque chose de l’ordre de la figuration/
défiguration du corps humain, qui fut la marque du très grand cinéma d’art
martial chinois, s’abolit dans ce livre d’image climatisée. ». (Jean-Marc
Lalanne, essais L’Asie à Hollywood, p. 136) De fait, plutôt qu’un film
précurseur, il faut y voir un pont entre deux traditions cinématographiques
mais également un point d’appui (financier) pour des studios occidentaux
avides de capitaliser sur le même créneau (3),
tout comme un point d’appui (culturel ?) pour des spectateurs avides de
nouveaux horizons : « Tigre et Dragon fut le point de masse critique
où plus personne ne pouvait être en désaccord et devait admettre qu’il y
avait là quelque chose. Et avec un tel accueil du public viennent de nouvelles
opportunités pour essayer encore plus de nouvelles choses ». (Mark Gill,
président de Miramax)
 En
France le premier film à franchir ce pont a été Fist of Legend et
de son succès dépendait en partie la possibilité de voir d’autres long-métrages
HK, du même style, débarquer dans nos salles. Bénéficiant d’une petite semaine
de promotion et avec une diffusion somme toute limitée (101 copies), Fist
of Legend a tout de même totalisé plus de 310 000 entrées en fin d’exploitation.
Succès public et succès critique également puisque rares ont été les articles
négatifs à son encontre, que ce soit dans la presse spécialisée ou généraliste.
Ce regain d’intérêt est confirmé par les sorties successives, sur le marché
domestique, de VHS en français jusqu’alors disponibles seulement dans la
collection HK (à l’adresse des amateurs plus que du grand public). On peut
aujourd’hui se procurer, dans beaucoup de vidéoclubs, des films comme Evil
Cult, Il était une fois en Chine,
ou Drunken Master 2 tandis que
les chaînes de télévision multiplient les soirées thématiques consacrées
au cinéma asiatique, l’installant définitivement dans le quotidien du plus
grand nombre. L’écho donné dans la presse cinéma, ces derniers temps, aux
premiers DVD de la collection HK témoignent ainsi du chemin parcouru. La
sortie sur grand écran, en Janvier 2002, de Taï-Chi Master a constitué
un autre baromètre de ce phénomène et même s’il n’a fait que la moitié des
entrées (150 000) de Fist of Legend, la performance reste encore
appréciable compte tenu de sa diffusion restreinte (95 copies). De là à
supposer, en se livrant à une arithmétique de comptoir, que le seuil minimum
de spectateurs adeptes de la « tatane en scope » se situe aux alentours
de 300 000 personnes…
En
France le premier film à franchir ce pont a été Fist of Legend et
de son succès dépendait en partie la possibilité de voir d’autres long-métrages
HK, du même style, débarquer dans nos salles. Bénéficiant d’une petite semaine
de promotion et avec une diffusion somme toute limitée (101 copies), Fist
of Legend a tout de même totalisé plus de 310 000 entrées en fin d’exploitation.
Succès public et succès critique également puisque rares ont été les articles
négatifs à son encontre, que ce soit dans la presse spécialisée ou généraliste.
Ce regain d’intérêt est confirmé par les sorties successives, sur le marché
domestique, de VHS en français jusqu’alors disponibles seulement dans la
collection HK (à l’adresse des amateurs plus que du grand public). On peut
aujourd’hui se procurer, dans beaucoup de vidéoclubs, des films comme Evil
Cult, Il était une fois en Chine,
ou Drunken Master 2 tandis que
les chaînes de télévision multiplient les soirées thématiques consacrées
au cinéma asiatique, l’installant définitivement dans le quotidien du plus
grand nombre. L’écho donné dans la presse cinéma, ces derniers temps, aux
premiers DVD de la collection HK témoignent ainsi du chemin parcouru. La
sortie sur grand écran, en Janvier 2002, de Taï-Chi Master a constitué
un autre baromètre de ce phénomène et même s’il n’a fait que la moitié des
entrées (150 000) de Fist of Legend, la performance reste encore
appréciable compte tenu de sa diffusion restreinte (95 copies). De là à
supposer, en se livrant à une arithmétique de comptoir, que le seuil minimum
de spectateurs adeptes de la « tatane en scope » se situe aux alentours
de 300 000 personnes…
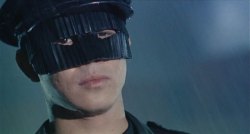 Nos
voisins américains s’y sont mis légèrement plus tôt puisque dès la fin des
années 90 sortaient sur quelques écrans Black
Mask, dans une version remaniée, suivi ensuite par Drunken
Master 2 et quelques autres Jackie Chan.
Entre temps le triomphe surprise de Tigre et Dragon est
venu stimuler l’intrépidité des studios et Miramax n’a pas hésité à mettre
la main au portefeuille pour la diffusion nationale de Iron Monkey,
dans un parc relativement conséquent de salles. Ce sont donc 2 millions
de dollars US qui ont été consacrés à la « restauration » du film (l’image
est de meilleure qualité mais on a perdu les superbes musiques originales
au profit d’un son plus « rock ») en plus des 10 millions nécessaires au
tirage des 1250 copies réservées à la distribution. Les frères Weinstein
n’ont pas lésiné sur les moyens, eut égard au « standing » du matériau de
base, pour assurer le succès d’un film vieux de huit ans et qui était déjà
en son temps, selon les standards techniques hollywoodiens de l’époque,
« dépassé ». Bien entendu, l’espoir de capitaliser sur le nom de Woo Ping
y est pour quelque chose mais il y a également plus qu’un réflexe de rentabilité
à court terme, Miramax ayant un deal d’exclusivité avec Metropolitan Filmexport,
société détentrice d’un catalogue important de films HK (4).
Quoi qu’il en soit la sortie de Iron Monkey est au moins amortie
puisqu’en bout d’exploitation il totalise plus de 15 millions de dollars
de recettes, ce qui est certes ridicule en comparaison des produits issus
des grands studios américains mais honorable pour un « sombre film de karaté ».
Et en y regardant de plus près on constate qu’il s’est non seulement octroyé
une honorable sixième place au box office dans la première semaine, mais
aussi un très bon ratio de recettes par copie pour la même période, juste
derrière le premier du box office (Training Day) à la même époque !
Performance d’autant plus notable que Iron Monkey bénéficiait d’une
diffusion moins importante (1250 contre 3000 salles), ce qui laisse penser
que son « potentiel d’intérêt » était supérieur aux résultats obtenus.
Nos
voisins américains s’y sont mis légèrement plus tôt puisque dès la fin des
années 90 sortaient sur quelques écrans Black
Mask, dans une version remaniée, suivi ensuite par Drunken
Master 2 et quelques autres Jackie Chan.
Entre temps le triomphe surprise de Tigre et Dragon est
venu stimuler l’intrépidité des studios et Miramax n’a pas hésité à mettre
la main au portefeuille pour la diffusion nationale de Iron Monkey,
dans un parc relativement conséquent de salles. Ce sont donc 2 millions
de dollars US qui ont été consacrés à la « restauration » du film (l’image
est de meilleure qualité mais on a perdu les superbes musiques originales
au profit d’un son plus « rock ») en plus des 10 millions nécessaires au
tirage des 1250 copies réservées à la distribution. Les frères Weinstein
n’ont pas lésiné sur les moyens, eut égard au « standing » du matériau de
base, pour assurer le succès d’un film vieux de huit ans et qui était déjà
en son temps, selon les standards techniques hollywoodiens de l’époque,
« dépassé ». Bien entendu, l’espoir de capitaliser sur le nom de Woo Ping
y est pour quelque chose mais il y a également plus qu’un réflexe de rentabilité
à court terme, Miramax ayant un deal d’exclusivité avec Metropolitan Filmexport,
société détentrice d’un catalogue important de films HK (4).
Quoi qu’il en soit la sortie de Iron Monkey est au moins amortie
puisqu’en bout d’exploitation il totalise plus de 15 millions de dollars
de recettes, ce qui est certes ridicule en comparaison des produits issus
des grands studios américains mais honorable pour un « sombre film de karaté ».
Et en y regardant de plus près on constate qu’il s’est non seulement octroyé
une honorable sixième place au box office dans la première semaine, mais
aussi un très bon ratio de recettes par copie pour la même période, juste
derrière le premier du box office (Training Day) à la même époque !
Performance d’autant plus notable que Iron Monkey bénéficiait d’une
diffusion moins importante (1250 contre 3000 salles), ce qui laisse penser
que son « potentiel d’intérêt » était supérieur aux résultats obtenus.
Le cas Iron Monkey
« Dans
le passé c’était les grands films Italiens et Français qui parlaient à une
génération. Mais aujourd’hui ce sont les films asiatiques qui proposent
de très bonnes histoires pleines de fantaisie et une poésie, un sens enfantin
du merveilleux. Lorsque j’ai vu Iron Monkey je me suis demandé comment on
pouvait hésiter à mettre ça en avant » déclarait un des frères Weinstein.
Mais les patrons de Miramax n’ont pas toujours tenu le même discours et
il fût un temps où le cinéma (de genre) asiatique leur passait au-dessus
de la tête. Et ce n’est pas par manque d’informations puisque ils eurent
très tôt connaissance de l’existence de Iron Monkey. C’est Quentin
Tarantino en personne, grand amateur de « sous culture », qui en parla la
première fois à ses deux amis Bo et Harvey : « J’ai parlé de Yuen à Miramax
voilà déjà 6 ans. Je leur ai dit « prenons Jet Lee et Donnie Yen dans un
film et donnons en la direction à Yuen Woo Ping ». Ils ont répondu par des
« ouais, ouais » et voilà tout. Et puis sont venus Matrix et Tigre et Dragon
et ils se sont alors intéressés au bizness des films d’action hongkongais. ».
Il n’est d’ailleurs pas étonnant de retrouver le réalisateur de Pulp
Fiction en première ligne de la promotion de Iron Monkey, nous
gratifiant d’un petit numéro de présentation enthousiaste, au début d’une
des bandes annonces. Harvey Weinstein parut en tout cas assez confiant pour
mettre « 2 millions de dollars dans le film juste pour le coût de la
restauration. Nous avons pris un nouveau compositeur pour faire une nouvelle
musique (sic !) : il y a une nouvelle bande sonore en stéréo, avec
de nouveaux mixages et des effets sonores. Tout a été première classe, nous
avons même fait le mixage au ranch Skywalker ».
Donnie Yen, acteur principal du film, en reste lui-même le premier étonné. Sa présence dans le casting est pourtant une des raisons qui a poussé Miramax à consentir son investissement. Bien qu’encore relativement inconnu aux Etats-Unis (on l’a brièvement aperçu dans High(aïheeuuu)lander 4), il a signé un contrat de trois films avec le studio qui compte bien en faire une vedette de premier plan, au même titre qu’un Jet Lee. Car dans la situation actuelle du « hero movie », de plus en plus nombreux sont ceux qui pensent que les acteurs martiaux asiatiques peuvent constituer une alternative viable aux vieillissants Stallone, Schwarzie et Willis. Miramax croit donc dans les chances de Yen comme l’attestent les propos de son président : « …on peut dire que Jet Lee a d’énormes capacités, tout comme Jackie Chan. Mais je pense que dans le cas de Donnie c’est juste un charisme énorme ». Et à ceux qui doutent il cite en exemple le cas des acteurs afro-américains, lorsque « les gens croyaient qu’il n’y avait de la place que pour deux acteurs afro-américains dans le box-office. Maintenant c’est prouvé que cela était totalement faux. Je pense qu’il va se passer la même chose avec les stars asiatiques qui sont installés pour longtemps. Je pense que tout est sur le point de changer ». Si la digestion artistique n’est pas forcément assurée, celle des acteurs est en bonne voie.
Le cas Iron Monkey traduit assez bien l’évolution, au cours de ces dernières années, des exécutifs américains envers le cinéma d’action asiatique et la place que celui-ci tend à occuper auprès d’une partie du public. Donnie Yen n’exprime pas autre chose (du point de vue de sa personne) en indiquant que « c’est un très bon bizness pour eux (Miramax) de sortir Iron Monkey car il n’y a pas meilleur moment que maintenant. Iron Monkey est le véhicule parfait après Tigre et Dragon. Je pense que le public est maintenant assez mature et a faim de ce type de films. L’audience est prête pour les dialogues en chinois, les câbles et de la bonne action ». Reste à savoir dans quelle mesure de tels films seront exploités dans le long terme.
Pour autant, ces diverses sorties marginales d’œuvres authentiques ne doivent pas masquer la réalité d’un cinéma d’action occidental -d’une industrie- fonctionnant, dans sa dynamique d’assimilation, sur le mode d’un recyclage superficiel de figures de style basiques propres au cinéma HK. Vidées de leur valeur narrative et dès lors allégées de ce qui leur donnait sens, ces figures de style risquent de devenir, à terme, chaque jour plus galvaudées et donc plus lourdes à digérer. Car pour quelques sorties tardives de classiques originaux on nous afflige quantités d’ersatz « américanisés » d’autant plus dopés aux effets numériques que leurs chorégraphies sont poussives et ennuyeuses. Si le bilan peut paraître aussi négatif devant une telle avalanche de vrais films occidentaux faussement hongkongais, c’est en raison d’une comparaison forcément à l’avantage des modèles originaux. Mais quand la majorité des productions se contentent de « singer » un certain cinéma asiatique, il en est d’autres, également issus des grands studios, qui s’approprient certaines techniques caractéristiques du cinéma de genre HK mais dans le cadre d’un patrimoine typiquement occidental. Hollywood, et dans une moindre mesure un pan du nouveau cinéma de genre français, cherche encore la bonne formule –si tant est qu’elle existe- d’une intégration réussie.
Hybridation débridée (ou la voie de « l’intégration culturelle » ?)
 Le
savoir-faire et les hommes sont donc passés mais la magie est restée
aux portes d’Hollywood. The One en apporte encore
la confirmation car malgré ses résultats honorables et les
moyens mis à disposition au service de Jet Lee, ce film n’est
ni plus ni moins que du calibre d’un Time Cop en mieux chorégraphié et
plus cher. Mais même dans le domaine des combats, malgré la
présence très active de Corey Yuen-Kwai dans
leur mise au point, The One reste plombé par un montage mollasson
et un cadrage brouillon. Un mal assez récurrent des prestations
occidentales de Jet Lee qui ne trouve plus le réalisateur capable
de le filmer correctement. Il semble loin le temps des grands rôles
et nul doute que l’absence de « natte mandchoue » y
soit pour quelque chose. En d’autres mots, hors contexte culturel
chinois le charisme de Jet Lee ne trouve plus de véhicule cinématographique
adapté, tout comme le cinéma d’arts martiaux (kung-fu
et wu xia pian) perd une bonne part de sa substance narrative, de son sens
du dramatique et de sa puissance, « physique », d’évocation : « La
maîtrise et la morale des arts martiaux ont été dévoyées
avec le passage à Hollywood. C’est frappant quand on compare
Fist of Legend (1994) avec les films que tourne Jet Li aujourd’hui.
Il a totalement laissé tomber la pureté de ses intentions
en tant que combattant, alors que dans Fist of Legend, la mise en scène
s’appliquait à décrire, à l’intérieur
même du combat, les affrontements moraux entre les différents
adversaires et leur respect réciproque. » (Christophe
Gans, essais L’Asie à Hollywood, p. 113)
Le
savoir-faire et les hommes sont donc passés mais la magie est restée
aux portes d’Hollywood. The One en apporte encore
la confirmation car malgré ses résultats honorables et les
moyens mis à disposition au service de Jet Lee, ce film n’est
ni plus ni moins que du calibre d’un Time Cop en mieux chorégraphié et
plus cher. Mais même dans le domaine des combats, malgré la
présence très active de Corey Yuen-Kwai dans
leur mise au point, The One reste plombé par un montage mollasson
et un cadrage brouillon. Un mal assez récurrent des prestations
occidentales de Jet Lee qui ne trouve plus le réalisateur capable
de le filmer correctement. Il semble loin le temps des grands rôles
et nul doute que l’absence de « natte mandchoue » y
soit pour quelque chose. En d’autres mots, hors contexte culturel
chinois le charisme de Jet Lee ne trouve plus de véhicule cinématographique
adapté, tout comme le cinéma d’arts martiaux (kung-fu
et wu xia pian) perd une bonne part de sa substance narrative, de son sens
du dramatique et de sa puissance, « physique », d’évocation : « La
maîtrise et la morale des arts martiaux ont été dévoyées
avec le passage à Hollywood. C’est frappant quand on compare
Fist of Legend (1994) avec les films que tourne Jet Li aujourd’hui.
Il a totalement laissé tomber la pureté de ses intentions
en tant que combattant, alors que dans Fist of Legend, la mise en scène
s’appliquait à décrire, à l’intérieur
même du combat, les affrontements moraux entre les différents
adversaires et leur respect réciproque. » (Christophe
Gans, essais L’Asie à Hollywood, p. 113)
 Aussi,
que les films soient bons ou mauvais, aucune des productions occidentales « post-matrixienne » n’a
vraiment réussie à capter et à restituer la spécificité,
la « substantifique moelle », du cinéma d’arts
martiaux. Coincé entre hommages opportunistes et « démagos » (Le
Baiser Mortel du Dragon), contrefaçons vulgaires (Hors
Limites, avec Steven Seagal) et copié/collé roublard
(The Musketeer, de Peter Hyams), ce dernier ne
subsiste plus que par son côté spectaculaire mais désincarné,
au mieux, ou alors réduit à quelques misérables « gimmicks » : « Depuis
(Matrix), la connexion Asie-Amérique fonctionne à plein régime,
parfois jusqu’à l’épuisement. Le style des maîtres
est devenu un cliché visuel fatigant et banal qu’on retrouve
dans les James Bond, L’Arme Fatal 4 ou dans la catastrophique série
des Mortal Kombat. (...) Aujourd’hui, il (le style) est devenu
une succession d’effets mécaniques lassants que le public
doit subir dans des films dépourvus d’âme comme The
Mummuy Return ou Tomb Raider/ Lara Croft. » (Nicolas Saada,
ibidem, p. 87). Et il ne faudrait pas croire que la France soit épargnée
par ce syndrome puisque une partie de la vague de films de genre qui voient
le jours ces derniers temps, productions Besson et autres, prolongent également
avec plus ou moins de bonheur (plutôt moins d’ailleurs...)
la dynamique hollywoodienne.
Aussi,
que les films soient bons ou mauvais, aucune des productions occidentales « post-matrixienne » n’a
vraiment réussie à capter et à restituer la spécificité,
la « substantifique moelle », du cinéma d’arts
martiaux. Coincé entre hommages opportunistes et « démagos » (Le
Baiser Mortel du Dragon), contrefaçons vulgaires (Hors
Limites, avec Steven Seagal) et copié/collé roublard
(The Musketeer, de Peter Hyams), ce dernier ne
subsiste plus que par son côté spectaculaire mais désincarné,
au mieux, ou alors réduit à quelques misérables « gimmicks » : « Depuis
(Matrix), la connexion Asie-Amérique fonctionne à plein régime,
parfois jusqu’à l’épuisement. Le style des maîtres
est devenu un cliché visuel fatigant et banal qu’on retrouve
dans les James Bond, L’Arme Fatal 4 ou dans la catastrophique série
des Mortal Kombat. (...) Aujourd’hui, il (le style) est devenu
une succession d’effets mécaniques lassants que le public
doit subir dans des films dépourvus d’âme comme The
Mummuy Return ou Tomb Raider/ Lara Croft. » (Nicolas Saada,
ibidem, p. 87). Et il ne faudrait pas croire que la France soit épargnée
par ce syndrome puisque une partie de la vague de films de genre qui voient
le jours ces derniers temps, productions Besson et autres, prolongent également
avec plus ou moins de bonheur (plutôt moins d’ailleurs...)
la dynamique hollywoodienne.
La sensualité des images, l’énergie cinétique des combattants magnifiée par le montage et les richesses métaphoriques de l’univers des films d’arts martiaux, ne sont donc pas compatibles avec la « charte » graphique et idéologique en vogue à Hollywood. Cela tient avant tout aux contraintes inhérentes d’une industrie américaine essentiellement tournée vers l’exportation, dont la vocation « globalisante » (à savoir marchande) et les tendances monopolistiques impliquent un formatage très précis du « produit » (le film) qui, souvent, est synonyme de plus « vulgaire » dénominateur culturel commun. Combiné à ce phénomène et de façon concomitante, nous assistons aussi à un certain « embourgeoisement » de ceux qui incarnaient, récemment encore, un cinéma hongkongais fait d’exubérances visuelles et narratives où le sens du spectaculaire ne sacrifiait jamais à celui du spectacle : « La façon dont Jackie Chan, Jet Li et les autres vivent aujourd’hui à Hollywood... c’est la Riveria. Ils sont tous très contents, ils ont plein d’argent, mais ils ont perdu le sens de la rue, ce sens formidable du cirque. Du coup, le cinéma que pratiquent les hongkongais à Hollywood n’a plus d’attrait pour les fans. Il n’a plus la même puissance ni - j’insiste sur ce mot - le même érotisme.» (Christophe Gans, ibidem, p. 102)
La preuve par trois (mousquetaires)...
 Parmi
tous ces titres et la ribambelle d’autres n’ayant pas trouvé place
ici, il en est un qui synthétise particulièrement bien cette
tendance à l’assimilation « vulgaire »,
c'est-à-dire « sans âme », de l’héritage
asiatique : The Musketeer (2001). Œuvre
mineure et adaptation plus que médiocre de l’univers de Dumas,
ce film n’en a pas moins obtenu un bon accueil public lors de sa
sortie en salles aux Etats-Unis. Ici, dès le départ, l’ambition était
claire puisqu’il s’agissait de ressusciter le film de cape
et d’épée en y introduisant une bonne dose d’action à la
sauce HK. Pour ce faire la production s’est adjointe les services
d’un chorégraphe chinois reconnu, accompagné de son équipe
de cascadeurs, en n’hésitant pas à mettre son nom en
avant dans la promotion du film. C’est ainsi que Hung
Yan Yan, plus célèbre pour l’instant pour ses rôles
dans >OUATIC et The Blade (sans
mésestimer de ses qualités de chorégraphe), a été présenté pour
l’occasion comme « un des meilleurs chorégraphes
hongkongais » (5), au
mépris de la réalité de son influence marginale dans
le cinéma de l’ex.colonie. Seul réel attrait d’une
production définitivement insipide, l’apport de l’équipe
asiatique dans le traitement des scènes d’action est constamment
et systématiquement mis en avant dans toutes les interviews du DVD,
du réalisateur aux acteurs (même C. Deneuve y va de son petit
mot !) tous soulignent le travail capital des spécialistes ès
kung-fu.
Parmi
tous ces titres et la ribambelle d’autres n’ayant pas trouvé place
ici, il en est un qui synthétise particulièrement bien cette
tendance à l’assimilation « vulgaire »,
c'est-à-dire « sans âme », de l’héritage
asiatique : The Musketeer (2001). Œuvre
mineure et adaptation plus que médiocre de l’univers de Dumas,
ce film n’en a pas moins obtenu un bon accueil public lors de sa
sortie en salles aux Etats-Unis. Ici, dès le départ, l’ambition était
claire puisqu’il s’agissait de ressusciter le film de cape
et d’épée en y introduisant une bonne dose d’action à la
sauce HK. Pour ce faire la production s’est adjointe les services
d’un chorégraphe chinois reconnu, accompagné de son équipe
de cascadeurs, en n’hésitant pas à mettre son nom en
avant dans la promotion du film. C’est ainsi que Hung
Yan Yan, plus célèbre pour l’instant pour ses rôles
dans >OUATIC et The Blade (sans
mésestimer de ses qualités de chorégraphe), a été présenté pour
l’occasion comme « un des meilleurs chorégraphes
hongkongais » (5), au
mépris de la réalité de son influence marginale dans
le cinéma de l’ex.colonie. Seul réel attrait d’une
production définitivement insipide, l’apport de l’équipe
asiatique dans le traitement des scènes d’action est constamment
et systématiquement mis en avant dans toutes les interviews du DVD,
du réalisateur aux acteurs (même C. Deneuve y va de son petit
mot !) tous soulignent le travail capital des spécialistes ès
kung-fu.
Mais
la valeur ajoutée de « scènes d’action à la
HK » (à dire en un seul mot), loin de sauver le film
de P. Hyams, sombre avec ce dernier dans l’indigence et le plagiat,
notamment en calquant trois de ses séquences d’action clés
sur trois classiques de la filmographie de Tsui Hark : L’Auberge
du Dragon (un peu du 1er combat dans l’auberge), Time
and Tide (le combat « en rappel ») et OUATIC (le
final avec les échelles). Alors même si Hung Yan Yan a été de
toutes ces aventures « harkiennes » (en tant que
cascadeur, acteur ou chorégraphe), cela ne justifie en rien l’entreprise
de mystification sur laquelle repose l’existence de The
Musketeer : son réalisateur ambitionnait de renouveler
un genre en puisant dans un autre, mais il ne réussit au final qu’à trahir
ses deux sources « d’inspiration » sans jamais
les dépasser. Ce sont là les limites d’une posture « impérialiste » vis-à-vis
du cinéma asiatique (6) et d’une
approche superficielle de ce qui fait la particularité des scènes
de combat dans le cinéma d’arts martiaux HK. Instructive et
symbolique est, à cet égard, la scène « des échelles » en
comparaison avec son modèle hongkongais, où l’on mesure
les différences irrémédiables entre les deux approches.
Paradoxalement
et en voulant légitimement défendre son travail sur The
Musketeer, Hung Yan Yan pointe au mieux ce qui sépare les deux
versions lorsqu’il rappelle que « les deux films
ont une scène où le héros et le méchant sont
en équilibre sur une échelle (...). Dans le premier film (OUATIC) les
plans durent une seconde puis on coupe. Une ou deux secondes et on coupe.
Dans ce film, The Musketeer, nous montrons l’ensemble du mouvement
dans un seul plan. On voit le saut, la réception et le combat, passer
d’une échelle à une autre en un seul plan. ».
Bien entendu, le résultat est censé posséder bien
plus « d’émotion » que la scène
originale alors, qu’au final, il s’en trouve totalement dénué et
ce pour des raisons (outre l’inconsistance scénaristique du
film de P. Hyams) qui sous des dehors « techniques » sont
autant de divergences conceptuelles. Ainsi en est-il du montage où le
réalisateur américain substitue à l’approche « non
linéaire » hongkongaise (7),
un montage fait de (quelques) plans plus ou moins larges dégageant
autant d’énergie qu’une série de cartes postales
mises bout à bout. Cette vision « globalisante » prétendument
supposée nous en montrer plus (un « plein les yeux » bien
bourrin en somme) s’oppose de fait à ce que Tsui Hark nomme
la « vision fractionnée » : "Le principe
de la vision fractionnée d'un lieu ou d'une action - une bagarre,
par exemple - s'oppose à mon sens à une approche plus globale
des cinéastes américains, où la grandeur du décor,
l'immersion dans une ville, et la force dramatique du hors champ - la multiplication
des pôles de l'action - se trouvent mis en avant ».
Dans le cas des scènes faisant appel au registre des arts martiaux
cette volonté de « tout montrer », déjà présente
dans Tigre et Dragon, signifie surtout le renoncement à nous
livrer un point de vue particulier sur l’action, sur les personnages,
leur relation... Voilà de quoi conforter la thèse selon
laquelle « tout voir, c’est ne rien voir » et
qui s’applique parfaitement bien au cas présent. Car si l’art
du montage « épileptique » HK est en premier
lieu le fait de contraintes techniques synonymes de manque de moyens (8),
il s’est aussi structuré en véritable langage visuel,
pendant stylistique de la dimension discursive du combat dans les arts
martiaux (9).
 Dans
le film de P. Hyams la scène des échelles se résume
finalement à mettre en exergue, dans une volonté de surenchère,
les « atouts » de son budget (pour faire bref :
un chorégraphe et des cascadeurs chinois, des câbles et des
ordinateurs) et n’hésite pas, pour le coup, à faire
feu de tout bois (« On montre tout ! »). Au
contraire, cette même scène dans OUATIC et
son utilisation des échelles dans le duel final, en plus des vertus
spectaculaires d’un tel climax, définissent un espace physique
où vont s’exprimer, selon Tsui Hark, les philosophies de chacun
des personnages : « L’action est plus une représentation
romantique de la personnalité des protagonistes qu’une description
réaliste du kung-fu. Les attitudes traduisent des émotions.
Les affrontements ne sont pas une simple confrontation physique, ils s’attachent à décrire
l’opposition de deux expressions intellectuelles et émotionnelles.
Avant de combattre, les personnages se livrent à une multitude de
mouvements qui sont en fait une peinture de leur imagination et de leurs
réflexions quant à la stratégie du combat. Une sorte
de projection dans leur esprit pour mettre le spectateur dans la confidence. » (HK
Magazine 6, interview p. 43/44). Quant aux décors qui servent de
cadre à de tels moments, réduit à l’état
d’accessoires dans leurs versions américaines, « ils
doivent refléter l’état mental des protagonistes et
constituer la représentation métaphorique des problèmes
auquel ils sont confrontés. Prenez les échelles dans le premier
film. Elles créent une situation d’instabilité où il
faut sans cesse trouver le bon équilibre pour éviter que
tout l’édifice ne s’effondre. Mais elles sont aussi
une traduction de la situation particulière du héros, qui
doit composer subtilement avec différents groupes, chacune de ses
décisions pouvant avoir des conséquences catastrophiques. » (Tsui
Hark, ibidem). Il y a en fin de compte plus qu’une différence
de budget entre les deux versions d’une même scène,
c’est une véritable différence d’échelle des
valeurs...
Dans
le film de P. Hyams la scène des échelles se résume
finalement à mettre en exergue, dans une volonté de surenchère,
les « atouts » de son budget (pour faire bref :
un chorégraphe et des cascadeurs chinois, des câbles et des
ordinateurs) et n’hésite pas, pour le coup, à faire
feu de tout bois (« On montre tout ! »). Au
contraire, cette même scène dans OUATIC et
son utilisation des échelles dans le duel final, en plus des vertus
spectaculaires d’un tel climax, définissent un espace physique
où vont s’exprimer, selon Tsui Hark, les philosophies de chacun
des personnages : « L’action est plus une représentation
romantique de la personnalité des protagonistes qu’une description
réaliste du kung-fu. Les attitudes traduisent des émotions.
Les affrontements ne sont pas une simple confrontation physique, ils s’attachent à décrire
l’opposition de deux expressions intellectuelles et émotionnelles.
Avant de combattre, les personnages se livrent à une multitude de
mouvements qui sont en fait une peinture de leur imagination et de leurs
réflexions quant à la stratégie du combat. Une sorte
de projection dans leur esprit pour mettre le spectateur dans la confidence. » (HK
Magazine 6, interview p. 43/44). Quant aux décors qui servent de
cadre à de tels moments, réduit à l’état
d’accessoires dans leurs versions américaines, « ils
doivent refléter l’état mental des protagonistes et
constituer la représentation métaphorique des problèmes
auquel ils sont confrontés. Prenez les échelles dans le premier
film. Elles créent une situation d’instabilité où il
faut sans cesse trouver le bon équilibre pour éviter que
tout l’édifice ne s’effondre. Mais elles sont aussi
une traduction de la situation particulière du héros, qui
doit composer subtilement avec différents groupes, chacune de ses
décisions pouvant avoir des conséquences catastrophiques. » (Tsui
Hark, ibidem). Il y a en fin de compte plus qu’une différence
de budget entre les deux versions d’une même scène,
c’est une véritable différence d’échelle des
valeurs...
Christophe Gans parlait « d’érotisme » à propos du cinéma hongkongais. On peut dire de la vision proposée par l’industrie du cinéma occidental à travers sa réinterprétation, à l’image de The Musketeer, qu’elle est au bon ciné HK ce que les mauvais films pornos sont aux classiques du cinéma érotique : une déclinaison vulgaire du genre car vidée de toute sensualité, de toute ambiguïté, juste bonne à reproduire mécaniquement une gestuelle d’où la tête et le cœur sont désormais absents.
... ou la preuve par câbles ?
Tant que des films tenteront de singer le cinéma de genre HK tout en niant sa spécificité, en gros et définitivement son identité résolument chinoise, il est à craindre que la règle « du pire au même » continue encore à prédominer (malgré d’éventuelles exceptions car c’est d’une tendance dont il est question ici) ce mouvement d’intégration. Le constat peut paraître sévère mais il est à la mesure de l’entreprise de mutilation : d’un côté on remonte, réorchestre, voir ampute de plusieurs scènes les œuvres en provenance directe d’Asie, de l’autre on submerge le marché de contrefaçons maisons. Du « piratage culturel » légal en quelques sortes... En définitive il ne reste plus vraiment grand-chose, à l’arrivée, de ce qui fait l’intérêt de la dimension « martiale » de l’action dans le cinéma HK. Toutefois, il serait erroné de ne considérer que l’aspect négatif des choses puisque au-delà de l’incapacité, par nature, du cinéma occidental à restituer ce qui fait la force de « l’action à la HK », il reste néanmoins deux acquis aux allures de révolution : la vision chorégraphique de l’action et l’utilisation des câbles (10).
 Pour
ce qui est de l’approche chorégraphique de l’action,
vidée de toute fonction narrative, elle est avant tout digérée
pour ses qualités purement formelles d’emphase visuelle. Quant à l’utilisation
des câbles dans les scènes d’action, c’est ce
qui pouvait arriver de mieux pour redynamiser une imagerie du cinéma
d’action passablement essoufflée. Le développement
intensif, au cours de ces dernières années, des outils numériques
a de plus créé les conditions d’une rencontre « au
sommet » entre des technologies du futur et la science, quasi
artisanale, de l’utilisation des câbles. Ces deux outils combinés
permettent aujourd’hui d’envisager sérieusement la mise
sur pellicule d’univers, de personnages, propres à la mythologie
populaire moderne : les super héros des comics américains
s’apprêtent ainsi à envahir nos écrans (11).
Pour
ce qui est de l’approche chorégraphique de l’action,
vidée de toute fonction narrative, elle est avant tout digérée
pour ses qualités purement formelles d’emphase visuelle. Quant à l’utilisation
des câbles dans les scènes d’action, c’est ce
qui pouvait arriver de mieux pour redynamiser une imagerie du cinéma
d’action passablement essoufflée. Le développement
intensif, au cours de ces dernières années, des outils numériques
a de plus créé les conditions d’une rencontre « au
sommet » entre des technologies du futur et la science, quasi
artisanale, de l’utilisation des câbles. Ces deux outils combinés
permettent aujourd’hui d’envisager sérieusement la mise
sur pellicule d’univers, de personnages, propres à la mythologie
populaire moderne : les super héros des comics américains
s’apprêtent ainsi à envahir nos écrans (11).
Brian Singer et son X-Men ont ouvert la voie en « blockbusterisant » avec succès le célèbre groupe de mutants de chez Marvel. Bien que sur papier les personnages créés par Stan Lee et Jack Kirby ne doivent rien au cinéma HK, il en va tout autrement lorsqu’il s’agit de les transposer sur grand écran, où se pose avec acuité la façon de restituer fidèlement, au moins dans l’esprit, les empoignades d’êtres aux capacités surhumaines. C’est donc sous la supervision de Corey Yuen Kwai (chorégraphe attitré de Jet Lee) et grâce à son expérience de l’utilisation des câbles que le bestiaire des mutants s’est animé de manière « crédible ». Blade, avec Wesley Snipe, avait joué le rôle de précurseur et la réussite du film, malgré le manque de réputation du comics d’origine ainsi que de l’absence d’un chorégraphe asiatique attitré, devait beaucoup à l’orientation « asiatique » de ses choix de représentation. C’est fort logiquement que sa suite, Blade 2, a franchi le pas en s’attachant les services de Donnie Yen (également présent à l’écran dans un rôle secondaire) pour la direction des scènes d’action : le résultat est supérieur au premier film car tout en bénéficiant d’une touche « à la HK », cette suite met aussi en place ses propres références visuelles (qui doivent énormément au réalisateur Guillermo Del Toro), à la confluence de ses deux sources d’inspiration, lui permettant d’échapper au piège du « pastiche ». Ce que n’avait pas réussi le Black Mask de Daniel Lee, pour qui l’équation se posait en termes inverses (intégrer l’esprit comics dans le ciné HK), Blade 2 le réalise plutôt bien.
 Tout
autant que ces films, le récent Spider-Man de Sam Raimi doit également
quelques services à l’utilisation des câbles. Avec l’aide
décisive de sfx 3D toujours plus proche du photo réalisme,
les spectateurs peuvent aujourd’hui se rassasier des acrobaties du « monte
en l’air » qui, sans la « démocratisation » des
câbles, n’auraient probablement pas pu prétendre à un
tel « réalisme », à une telle fidélité à l’imagerie
du comics. Un des tours de force de cette adaptation, dans l’optique
qui nous intéresse, est d’avoir su exploiter l’approche
chorégraphique de l’action et les câbles dans un cadre
de références proprement originales (et occidentales), dans « l’esprit
de la BD » selon les puristes. Sans rien devoir directement
au cinéma HK (Sam Raimi avait déjà démontré de
bonnes dispositions dès ses débuts), l’énergie
de ce film est en partie tributaire de ses acquis. On ne s’étonnera
donc plus qu’une rumeur ait, en son temps, laissé entendre
qu’un chorégraphe comme Ching Siu-Tung,
auréolé de son travail sur Shaolin
Soccer, viennent jouer les conseillers de l’ombre sur un Spider-Man en
pleine phase de post-production (12).
Tout
autant que ces films, le récent Spider-Man de Sam Raimi doit également
quelques services à l’utilisation des câbles. Avec l’aide
décisive de sfx 3D toujours plus proche du photo réalisme,
les spectateurs peuvent aujourd’hui se rassasier des acrobaties du « monte
en l’air » qui, sans la « démocratisation » des
câbles, n’auraient probablement pas pu prétendre à un
tel « réalisme », à une telle fidélité à l’imagerie
du comics. Un des tours de force de cette adaptation, dans l’optique
qui nous intéresse, est d’avoir su exploiter l’approche
chorégraphique de l’action et les câbles dans un cadre
de références proprement originales (et occidentales), dans « l’esprit
de la BD » selon les puristes. Sans rien devoir directement
au cinéma HK (Sam Raimi avait déjà démontré de
bonnes dispositions dès ses débuts), l’énergie
de ce film est en partie tributaire de ses acquis. On ne s’étonnera
donc plus qu’une rumeur ait, en son temps, laissé entendre
qu’un chorégraphe comme Ching Siu-Tung,
auréolé de son travail sur Shaolin
Soccer, viennent jouer les conseillers de l’ombre sur un Spider-Man en
pleine phase de post-production (12).
Demain ce sont les Dardevil, Elektra, Hulk et autres Iron-Fist qui débarqueront dans les salles obscures, et pour qui connaît les « pouvoirs » acrobatiques de ces personnages, le doute n’est guère permis quant à l’utilisation intensive des câbles. Hollywood doit déjà en faire des kilomètres de réserves en attendant de désigner les chorégraphes de services...
A ce propos Donnie Yen racontait cette anecdote assez significative peut avant le tournage de Blade 2 : " I saw all of them. I see the work of all the Hong Kong filmmakers. Right before I went to Blade, I had this dinner table with Yuen and sit right next to him, kind of like master and student, and the whole table is all Hong Kong guys. You have his brother, who did Charlie's Angels, a couple of guys who just finished "Exit Wounds," some guys who worked on "The Matrix" - all of the successful Hong Kong action films were done by these guys! I'm about to do Blade! »
Christophe Gans rapporte, dans L’Asie à Hollywood (p. 89), une histoire instructive : « Il faut préciser que Tigre et Dragon n’a eu aucun succès à Hong Kong, où il est fréquemment l’objet de risées. J’ai pu le constater à plusieurs reprises, auprès de réalisateurs et d’acteurs de Hong Kong. Que se soient Tsui Hark ou certains acteurs comme Jackie Chan, ils ne s’approprient pas ce film, même s’ils sont contents de son succès. Ca me rappelle le cas de La Porte de l’Enfer de Teinosuke Kinugasa au Festival de Cannes en 1953 où l’on s’était aperçu, bien après la Palme d’Or, que le film avait été conçu par les Japonais pour les Occidentaux, à usage externe. Tigre et Dragon a un peu cette fonction aux yeux des hongkongais : un film lyophilisé à l’usage des Occidentaux. »
Voici ce qu’en dit Raymond Chow, le célèbre producteur hongkongais : "(...) Le film de Ang Lee a un très bon côté : c'est un exemple de merchandising efficace et de promotion bien menée, avec pour résultat un succès immense dans le monde entier, sauf à Hong Kong et en Chine ! C'est instructif. On comprend que nos spectateurs ont de la mémoire, et que le public américain est différent. Disons qu'il aime les bonnes manières, les tables bien dressées. Une fourchette à gauche, un couteau à droite (...). Les Chinois et les Asiatiques, comme les Français, savent apprécier la nourriture pour ce qu'elle est. Le plus important pour eux ce n'est pas le plat... Les américains ont tendance à penser que si les couverts ne sont pas exactement à la bonne place, le repas n'est pas bon. C'est une question de goût. Ang Lee est un cinéaste hollywoodien plus qu'un cinéaste chinois. Il sait mettre le couvert, il sait ce qu'il faut faire pour attirer le regard. Nul n'est forcé de suivre sa voie."
De plus Miramax a dans ses cartons le projet de créer sa propre chaîne câblée en mettant particulièrement à contribution son catalogue de films HK et asiatiques.
A la question d’un journaliste qui lui demandait s’il “était à l’aise d’être présenté comme le Légendaire Chorégraphe », Hung Yan Yan répondait : « j’essaye de faire comme si je n’avais pas entendu. »
Bien que ce ne soit pas le sujet de cet article il convient de noter un autre exemple d’une telle attitude, représenté par la récente boulimie de cinéma japonais de la part des producteurs hollywoodiens : plutôt que de favoriser la diffusion, outre-atlantique, de films comme Ring ou d’animes à succès, ces derniers préfèrent en faire des remakes live (Dragon Ball, Ninja Scroll). Des initiatives qui ne manquent pas de piquer la curiosité...
Cette approche « non linéaire » du montage dans les scènes de combat procède d’ambitions chorégraphiques bien plus sophistiquées que celles du cinéma occidental. Elle permet ainsi d’articuler de façon dynamique la décomposition extrême de l’action (multiplication des « gestes » dans les arts martiaux au cinéma) et la « vision fractionnée » (multiplication des points de vue sur l’action) si chère à Tsui Hark. La décomposition de l’action (ou du mouvement), qui relève directement d’une logique de démonstration martiale où priment la lisibilité des techniques employées (réelles ou imaginaires) et les séquences d’enchaînements de coups, s’inscrit dans une perspective linéaire : il s’agit de souligner une succession continue de phases clés dans l’action décrite. C’est avec l’emphase toujours plus poussée de ces séquences, tout au long de l’histoire du cinéma HK, qu’est venue s’introduire la discontinuité dans ce bel ordonnancement. Dramatiser une action, un mouvement, ce n’est plus simplement en rendre compte mais raconter (ou conter plutôt), c’est à dire opérer des choix dans la façon de présenter l’action afin d’inspirer certaines émotions et/ou sensations. La « vision fractionnée », cette multitude de point de vue sur une même action, aide à construire ce regard décalé en servant d’appui à l’élaboration d’une représentation dramatique sur la représentation physique. Ainsi se créent des rythmes singuliers qui brisent l’uniformité temporelle de la décomposition et des séquences à chaque choix de mise en scène de la chorégraphie. Les nécessités du montage ne suivent plus dès lors, constamment, la logique linéaire des mouvements enchaînés attachée à une vision purement démonstrative (The Musketeer) de l’action. Les scènes de combat passent ainsi d’un statut illustratif à celui de moments majeurs de la narration où les « effets » si caractéristiques du cinéma d’arts martiaux, jouant en majorité sur l’altération des perceptions de l’espace et du temps, sont autant de discontinuités fulgurantes chargées de créer, de souligner ou de véhiculer une émotion, une sensation, un discours... Quand Jackie Chan utilise dans ses films sa technique de montage « un seul coup, deux plans rapides et différents » dans un soucis de style et de dynamisme, il rompt virtuellement la linéarité « physique » de la séquence (après tout, une pellicule est une ligne...) en y introduisant l’idée de simultanéité. Lorsque c’est Van Damme qui utilise la même technique pour ses fameux coups de pieds retournés, allant jusqu'à tripler le nombre de plans, on en retient pourtant qu’une pénible, voir risible impression de répétition. Disparue l’idée de simultanéité propre à décupler la force d’impact de la séquence. Est-ce l’artiste martial qui est en cause (et encore, c’en est un !) ? Sa « chorégraphie » ? La longueur des plans ? Les choix de cadrage... ? Quoi qu’il en soit la technique perd beaucoup dans le voyage jusqu’aux Etats-Unis, trop même.
Encore pourrait-on voir dans ce « constat » une forme de procès d’intention dans le sens où l’on entend par « contraintes techniques » une faiblesse relative à ce qu’est capable, sur le même terrain (celui des sfx dans les chorégraphies), le cinéma hollywoodien à un moment donné. En effet, la possibilité de « tout montrer » est principalement consécutive à l’utilisation des outils numériques qui permettent d’effacer les câbles ou de retoucher le plan. Or, « force » est de constater qu’avant la démocratisation de ces technologies, au début des années 80, le cinéma HK faisait déjà des films d’arts martiaux depuis un bon bout de temps et possédait des bases autrement plus solides que son homologue américain dans le domaine de la mise en scène des combats. Plutôt que de voir le « montage à la HK » comme un palliatif (signe d’un point de vue « occidentalocentrique » ?) alors qu’il était une réponse à un problème que ne se posait même pas encore le cinéma occidental, mieux vaut considérer son avance artistique et technique dans le domaine.
Cette divergence profonde entre le cinéma d’action HK et hollywoodien n’est pas sans faire penser aux différences qui existent entre la BD occidentale (européenne et comics) et le manga, notamment en ce qui concerne le découpage des planches, ce qui a des incidences sur les rythmes de narration : un combat dans un manga est généralement constitué de beaucoup de vignettes (cases), tout comme le nombre de plans d’un combat dans un film HK. Dans les deux cas ceci a pour conséquence d’élever le rythme de l’action, en particulier pour le cinéma hongkongais qui n’a eu de cesse de raccourcir la longueur de ses plans tout au long de son histoire. Il suffit de voir la façon dont un maître du genre tel que Shirow découpe et met en page ses scènes d’action pour que cette correspondance saute aux yeux.
Si les câbles (comment volait Superman ?) et les chorégraphies des scènes de combat (pensez aux films de cape et d’épée...) ne sont pas nouveaux dans le cinéma occidental, la systématisation de la combinaison des deux était par contre, jusqu’à maintenant, l’apanage quasi exclusive du cinéma HK et de ses chorégraphes, cascadeurs, combattants et techniciens.
Le problème de l’adaptation des jeux vidéo (dans la cas présent et plus spécialement, des jeux de combat), autre réservoir de « mythologies populaires modernes », ne sera pas abordé ici car il constitue un sujet en tant que tel, bien plus intéressant par ailleurs dans une perspective vidéo ludique que purement cinématographique. De plus, contrairement aux comics, les jeux vidéo n’ont pas encore trouvé leurs dignes représentants sur pellicules et on attend donc de voir ce que donnera le Soul Calibur de Sammo Hung ou la « vraie » adaptation de Tekken, en particulier du point de vue de la représentation de l’action.
En fait, pendant que le film était encore en post-production, une rumeur dont s’était entre autres fait l’écho le site Aintitcool, assurait de l’existence de contacts entre la production et... Hung Yan Yan ! Plus tard c’est Ching Siu-Tung qui a été crédité, lors d’un voyage de quelques semaines aux Etats-Unis, d’une visite auprès de S. Raimi... Fiction ou fiction ? Quoi qu’il en soit, ne serait-ce que pour l’avoir imaginé, cela reste assez significatif...